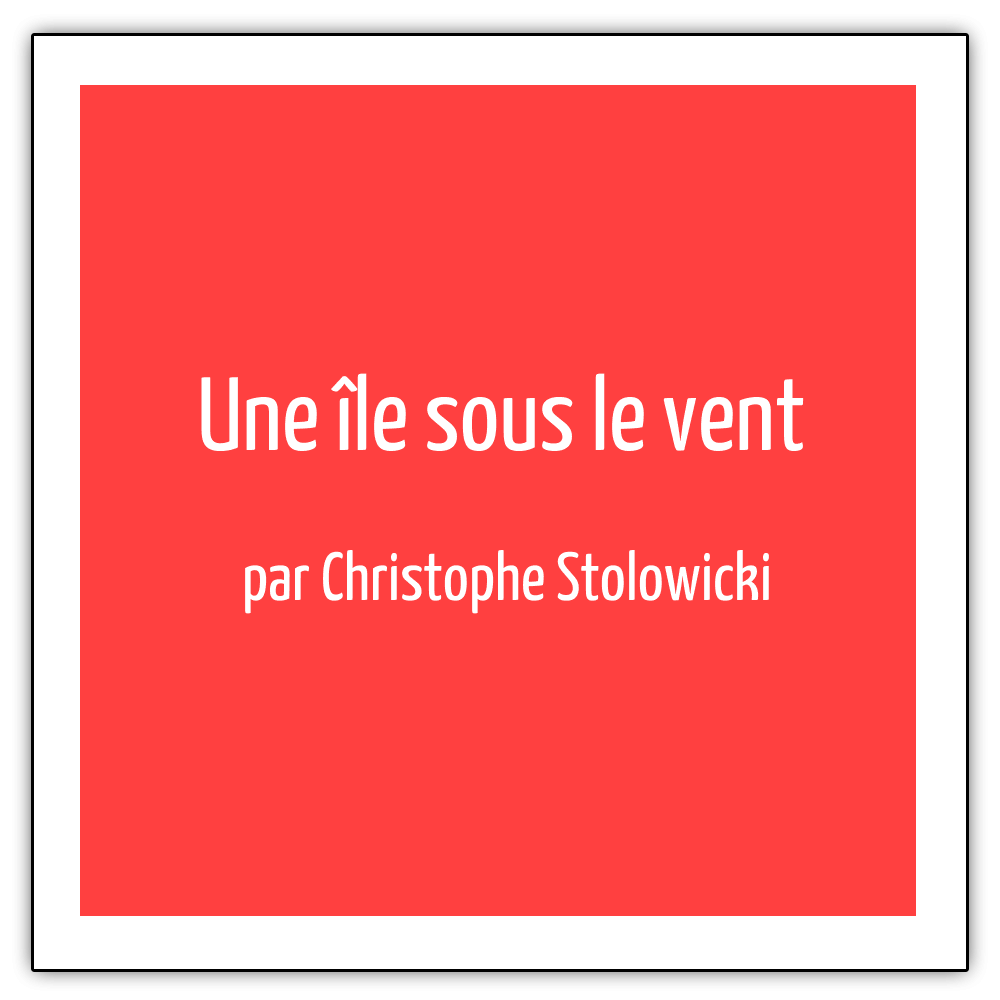Une île sous le vent par Christophe Stolowicki
- Partager sur :
- Partager sur Facebook
- Épingler sur Pinterest
J’écris d’un angle mort dans la sylve des siècles et les déchèteries de mon temps, celles où parmi les cristaux enduits d’immondices j’ai composé mes premiers poèmes à l’âge tendre, celui d’avant le vert paradis. On imagine que l’homme ne peut pas survivre à tant de laideur et l’on est tout surpris de le retrouver un siècle après, ayant compris sa leçon et décru, commençant à décroître. Cela se nomme résilience.
Je me suis réveillé haletant au sortir d’un rêve où je disais le non-art d’écrire à des écoliers cabotins. Il n’avait pourtant rien d’un cauchemar. Quelles péripéties récentes en sont la source offre peu d’intérêt, même pour moi seul. Mais peut-être le nom de l’écrivain que je découvre à son long cours d’écrire, à une vitesse précise hallucinante, René Crevel, qui s’est suicidé à trente-cinq et qui l’annonce dix ans à l’avance, bisexuel qu’André Breton se permet de gifler sur scène.
Pourquoi le clavecin, puis le piano, sont-ils l’instrument qui a le plus d’affinité avec l’écriture ? Ne pas me presser de répondre, elle répondra pour moi, à touches serrées, desserrées, à touche en bouche, à couches de notes recouvrant de leur réseau mes secrets. De Scarlatti (dont je me repasse les Sonates), Bach, à Monk, Bill Evans, Enrico Pieranunzi, les doigts courent, les mains se croisent et décroisent, décruée la prise de parole fait courir ses caractères écrits. Avec le clavier de l’instrument celui alphabétique de la mise à nu, au net, de mes réflexions cultive sa parenté, pare en t, de tierce en quarte en prime, les coups de taille ou d’estoc dont se fendent mes adversaires, mes ennemis. Comme sur le tableau d’Hokusai où s’affrontent rampant et pic en tête. L’écriture pianistique est le rampant.
Maintenant c’est Monk Plays Duke Ellington que je me suis remis, ce que j’entends est l’accent, oh certes pas étranger, Monk s’inscrit dans la plus pure tradition du jazz, qu’il accomplit ici sur les brisées du Duke, sans rien d’hispanisant, pas même ce peu que Miles Davis convertit dans Flamenco Sketches, non, un accent qui lui est propre, qu’il a cultivé par son art retors rétractile – je comprends soudain que c’est le mien que j’entends, qui jaillit dans Le harem vertical après que je l’eus longuement travaillé dans Ou l’impunité, aussi sourd qu’aveugle, qu’anosmique, perceptible à la seule lecture, concocté à froid dans une arrière-cuisine, une souillarde où s’exalte ce que je souille, fouille, foule, dérouille, déroule comme le papyrus de mon âme.
En tordant le cou à l’accent juif, j’ai écrasé quelques antisémites au passage.
Suicides d’adolescents prolongés, écrivains de première force, René Crevel que je viens de découvrir, mais après lui Alejandra Pizarnik, Guy Viarre, sur qui à la trentaine passée se referme l’impasse après que des mots compressés ont jailli – mais qui ne sont pas le génie, unique, Rimbaud qui, tandis que l’impasse se refermait sur lui dix ans plus tôt que sur ses séides, a ouvert à la poésie, à la littérature, à tout l’art, car ni peintres ni photographes ni musiciens, sinon les jazzmen historiques, ne connaissent cette pression de s’accomplir avant un âge fatidique, a ouvert une ère nouvelle. Gombrowicz l’a senti qui en écrivant Ferdydurke a franchi le cap, d’inespérance, d’inexpérience, dont s’ensuit son œuvre seconde. Gombrowicz qui, si ce n’est dans les dernières années de son Journal, s’est toujours gardé de toute poésie, et y a même écrit un pamphlet, à entendre au second degré mâtiné de tierce en quarte, intitulé Contre les poètes.
Où il a suffi à Pascal de quelques mots, Gombrowicz débute son livre en se déchaînant contre les demi-habiles avec une rage qui eût dû lui aliéner à jamais leur demi-masse, leurs masques et leur mascarade si l’amour-propre, le divin amour-propre ne les protégeait de ses coups de poignard.
Étrangement, se lançant dans les lettres, il vibre des mêmes accents dont je frémis à mon bouquet final.
De sommeil qui me prend, me surprend, en intensif réveil, ce n’est pas ici simplement un Journal, un récit sur le vif, sur le motif, c’est plus dense, plus intense, plus dépressurisé. C’est une épreuve.
Déjà il y a un demi-siècle, je ne connaissais pas le plaisir d’écrire mais comme tous ceux que j’aime, l’âpre volupté. Comme eux, j’en ai derechef le déferlement. Défaire le mensonge qui me ronge me tient en éveil. Ce que j’écris est toujours aussi inconvenant. Le pal pas PayPal, ni la pâle aube si elle ne tourne à l’aurore.
Près d’un siècle après René Crevel, dont je lis Le clavecin de Diderot (1932), Crevel dont la colère, ici par exception de grande orthodoxie surréaliste, oscille entre Lamartine et Anatole France comme objets, désormais insignifiants, je lève à nouveau le vent de la même exactement à l’inverse, contre la masse étouffante non contre les individus qui en émergent si mal. À l’inverse ? Certes. Mais la voix, l’accent, le tempo, la rhétorique, l’arrêt sur arrêts toniques que je dois au jazz sont les mêmes. Le miaulement. René Crevel, le grand ancêtre que m’a dégoté Henri Abril en lisant Le harem vertical.
Joëlle, j’ai enfin trouvé le mot, était fabuleusement vierge.
Est-ce d’avoir lu des fables de La Fontaine ? Je vais retourner à ce fabuliste, qui lui a fabuleusement réussi le pari d’être un écrivain populaire entre tous, le classique des classiques, et d’exceller dans son art avec un raffinement aristocratique à longue portée, l’impair sans le tragique de Shakespeare lui tenant lieu de chute, à qui il est parfois arrivé de manger / le berger – dont il faudra attendre Baudelaire pour connaître l’équivalent. Mais lui sans éveiller le courroux de son roi comme Baudelaire celui des bien-pensants, réussissant à se faire passer pour le bon La Fontaine alors qu’il fut mauvais père, mauvais époux, sujet se rebiffant contre son prince en se gardant bien de se rebeller contre son roi dont sous couvert d’apologues il écornifle le despotisme.
Et dédaigneux du plat Descartes et de ses animaux-machines, lui qui au moins observait les animaux. Là encore, il faudra attendre Gide (« Je sens, donc je suis ») pour en retrouver un équivalent.